Je connais K. par des voies qui auraient dû placer nos rapports sur le plan strict de la cordialité, excluant tout affect. Mais nous avions des points communs comme le cinéma, la littérature, et la fascination pour l'acte créatif. Et en adultes dignes de ce nom, K. et moi avons pris acte des barrières qui devaient théoriquement nous opposer comme d'une mouche au dessus de nos têtes.
Aujourd'hui K. est enceinte. Je ne l'avais pas vue depuis de nombreux mois et, si j'avais eu vent de son état, je n'avais pas cherché à en parler avant elle. Nous ne sommes pas assez proches pour que j'ai pu m'offusquer de son silence, loin s'en faut. Une fête de fin d'année nous a réunis, et son ventre est bien rond. Elle ne le cache pas. Elle reste discrète sur le sujet. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de féliciter cette jeune femme en pleine création. Voici sa réaction.
En soi je trouve très beau ce texte volé à un e-mail, parce que très simple et gorgé de raccourcis qui en disent long sur la qualité de celle qui les a pris. Je trouve les mots de K. d'une maturité assourdissante sur ce que signifie "attendre un enfant". J'y puise une belle matière. Enfin il y a quand même quelques phrases qui font jaillir ce petit bouillon dans la gorge, quand un texte est juste et touchant.
PS. K. est d'origine étrangère, d'où ces charmants dérapages dans le texte. Je les ai laissés tels quels, je sais qu'elle ne m'en tiendra pas rigueur. Ce n'est pas que K. se contre fiche des lacunes sans importance que son origine entraîne, au contraire : elle les assume pleinement.
"Merci pour tous les compliments au sujet de ma grossesse. J’essaie quand même de ne pas faire de ça un sujet de conversation mais c’est parfois difficile de l'éviter. Je ne voudrais pas généraliser, mais après sept mois plongée dans cette histoire, il me semble que les gens aiment parler de ça parce que quelque part ce que tu appelles “le projet” enlève toute différence existante, au moins on décide de le croire. Je pense à “Personne” de Bergman qui fait un point sur le sujet, parce qu’à mon avis la dépression de Marianne est du au fait qu’après avoir autant essayer de se différencier, la maternité l’a fait devenir n’importe qui. C’est pour quoi les gens me demandent partout des choses, ce qui n’était pas le cas avant, parce que sûrement ils pensaient que je n’avais rien à partager avec eux. Il faut dire que même mes voisins me disent bonjour depuis que mon ventre est devenu mon identité. Je me dis que peut-être je suis aussi devenue plus réceptive aux autres, moins renfermée. En tout cas, je suis un peu sur une nuage, inexplicable et au même temps un grand soulagement. C’est la première fois dans ma vie où je ne ressens pas la pression d’avoir à choisir, c’est comme si quelqu’un l’a fait déjà à ta place. Il ne me reste que de porter cette circonstance avec beaucoup de reconnaissance et de confiance."
Tuesday, December 26, 2006
Monday, December 25, 2006
Magie ou maléfice ?
Il s'agit d'une anecdote dans les pages people d'un site grand public. J. K. Rowling, la créatrice de Harry Potter, y déclare qu'elle a toutes les peines du monde à terminer l'écriture du dernier volet des aventures de son héros.
"J'ai très envie de terminer ce livre tout en n'y tenant pas.", dixit. Puis : "Je ne pense pas que l'on puisse imaginer ce que cela représente sans l'avoir vécu : exultation et frustration se succèdent sans répit. Je rédige en ce moment des scènes imaginées, pour certaines, il y a une douzaine d'années, voire davantage."
Ecrire enfin des scènes imaginées il y a longtemps, c'est les affronter. Ecrire une scène au moment même où on la pense est exaltant. Mais quand arrive le moment d'écrire ce qui a été pensé beaucoup plus tôt, quand vient le moment d'ouvrir son carnet de notes et d'y trouver les événements qui nous emmenaient si loin il y a quelques heures, quelques jours, "voire davantage", il y a une sorte de lutte, véritablement.
Une lutte pour retrouver l'enthousiasme, qui fait le plaisir d'écrire, et donc de lire. Pour ne pas abandonner une scène qui semble déjà moins importante au profit d'une autre qui nous vient, justement, à l'instant. Pour accepter de rompre avec un plaisir immmédiat afin de servir une oeuvre. Mais encore et surtout : pour se souvenir qu'une scène décalée dans le temps apporta son lot de bonheur, et plonger dans ce cocon qui la vit naître pour en retrouver l'essence. Oui, c'est une lutte difficile à imaginer, vraiment douloureuse parfois. Ecrire peut heurter physiquement. Nouer l'estomac. Alourdir réellement les épaules d'une charge éprouvante. Pour ma part, affronter a posteriori des scènes pensées plus tôt provoque souvent une sensation de dégoût, une regurgitation écoeurante, un travail scolaire répulsif. Il faut alors forcer son corps à reprendre le dessus.
Le plus admirable reste, quand on est aussi attendue que Mrs. Rowling, de l'avouer.

"J'ai très envie de terminer ce livre tout en n'y tenant pas.", dixit. Puis : "Je ne pense pas que l'on puisse imaginer ce que cela représente sans l'avoir vécu : exultation et frustration se succèdent sans répit. Je rédige en ce moment des scènes imaginées, pour certaines, il y a une douzaine d'années, voire davantage."
Ecrire enfin des scènes imaginées il y a longtemps, c'est les affronter. Ecrire une scène au moment même où on la pense est exaltant. Mais quand arrive le moment d'écrire ce qui a été pensé beaucoup plus tôt, quand vient le moment d'ouvrir son carnet de notes et d'y trouver les événements qui nous emmenaient si loin il y a quelques heures, quelques jours, "voire davantage", il y a une sorte de lutte, véritablement.
Une lutte pour retrouver l'enthousiasme, qui fait le plaisir d'écrire, et donc de lire. Pour ne pas abandonner une scène qui semble déjà moins importante au profit d'une autre qui nous vient, justement, à l'instant. Pour accepter de rompre avec un plaisir immmédiat afin de servir une oeuvre. Mais encore et surtout : pour se souvenir qu'une scène décalée dans le temps apporta son lot de bonheur, et plonger dans ce cocon qui la vit naître pour en retrouver l'essence. Oui, c'est une lutte difficile à imaginer, vraiment douloureuse parfois. Ecrire peut heurter physiquement. Nouer l'estomac. Alourdir réellement les épaules d'une charge éprouvante. Pour ma part, affronter a posteriori des scènes pensées plus tôt provoque souvent une sensation de dégoût, une regurgitation écoeurante, un travail scolaire répulsif. Il faut alors forcer son corps à reprendre le dessus.
Le plus admirable reste, quand on est aussi attendue que Mrs. Rowling, de l'avouer.

Sunday, December 10, 2006
Quel meilleur espace qu'une voiture pour écrire ?
Expérience intéressante ce week end. Entre Pornichet et Paris, dans une voiture. Rien à la radio, chaque occupant plongé dans ses pensées, le ronronnement du moteur et l'entrelacs hypnotique des feux blancs et rouges imprimés sur la nuit noire : pourquoi ne pas écrire ? Après tout, j'ai mon ordinateur portable et je ne conduis pas.
Après l'échec de ma dernière tentative il y a quelques jours, échec dû probablement à l'appel permanent d'un truc moins contraignant à faire, plus drôle ou au bénéfice plus immédiat (manger une cacahuète, embrasser Julie, lire mes mails, envoyer un sms...), voici probablement une occasion rêvée de me consacrer à mon texte pour un moment, sans craindre de me disperser. Bien sûr, même, quand on y pense : les yeux dans l'écran, l'obscurité partout, et surtout une plage considérable de temps libre, libre de tout, impossible de faire quoi que ce soit d'autre de productif, ou juste de divertissant : c'est dans cet ascétisme que je devrais travailler plus souvent. Et en effet, ça a payé. Le passage sur lequel je bloquais s'est délité après une poignée de minutes passées à y réflechir calmement. Du coup le texte a un peu dérapé vers ces digressions que j'apprécie ailleurs, et que je souhaite faire renaître dans mes livres. L'esprit a pris la route. Il s'est laissé porter par la nuit. Je ne suis pas mécontent du résultat et j'imagine déjà un bureau mobile idéal, chauffeur en livrée et les autoroutes de France pour toute inspiration. Qui plus est, rien de moins romantique qu'une autoroute, et je confirme ainsi que je ne peux écrire qu'en m'affranchissant du decorum qu'on prête à l'écrivain : pas de mer déchaînée, pas de montagne, pas de St-Germain-des-Près dans mon processus. Ascétisme.
A part ça, j'ai lu Terrasse à Rome entre deux lignes de L'Aveuglement, et m'est apparue l'hypothèse selon laquelle Pascal Quignard viserait dans l'écriture la même chose que Picasso en peinture quand ce dernier déclarait "J'ai passé ma vie à essayer de dessiner comme un enfant". Il y a souvent de l'enfantin chez Quignard. Pas du puéril. Un dépouillement ravissant. Le maître est l'enfant.
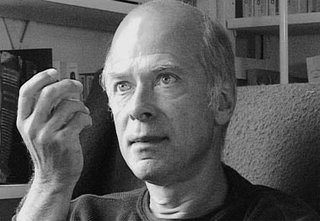
Après l'échec de ma dernière tentative il y a quelques jours, échec dû probablement à l'appel permanent d'un truc moins contraignant à faire, plus drôle ou au bénéfice plus immédiat (manger une cacahuète, embrasser Julie, lire mes mails, envoyer un sms...), voici probablement une occasion rêvée de me consacrer à mon texte pour un moment, sans craindre de me disperser. Bien sûr, même, quand on y pense : les yeux dans l'écran, l'obscurité partout, et surtout une plage considérable de temps libre, libre de tout, impossible de faire quoi que ce soit d'autre de productif, ou juste de divertissant : c'est dans cet ascétisme que je devrais travailler plus souvent. Et en effet, ça a payé. Le passage sur lequel je bloquais s'est délité après une poignée de minutes passées à y réflechir calmement. Du coup le texte a un peu dérapé vers ces digressions que j'apprécie ailleurs, et que je souhaite faire renaître dans mes livres. L'esprit a pris la route. Il s'est laissé porter par la nuit. Je ne suis pas mécontent du résultat et j'imagine déjà un bureau mobile idéal, chauffeur en livrée et les autoroutes de France pour toute inspiration. Qui plus est, rien de moins romantique qu'une autoroute, et je confirme ainsi que je ne peux écrire qu'en m'affranchissant du decorum qu'on prête à l'écrivain : pas de mer déchaînée, pas de montagne, pas de St-Germain-des-Près dans mon processus. Ascétisme.
A part ça, j'ai lu Terrasse à Rome entre deux lignes de L'Aveuglement, et m'est apparue l'hypothèse selon laquelle Pascal Quignard viserait dans l'écriture la même chose que Picasso en peinture quand ce dernier déclarait "J'ai passé ma vie à essayer de dessiner comme un enfant". Il y a souvent de l'enfantin chez Quignard. Pas du puéril. Un dépouillement ravissant. Le maître est l'enfant.
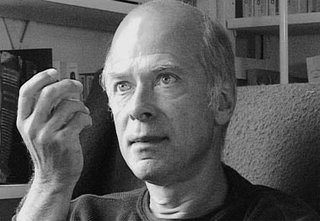
Monday, December 04, 2006
Aveugle comme les autres !
Toujours sur L'Aveuglement. Je reprends les transports en commun pour pouvoir lire enfin.
La première sensation face à Saramago fut un peu plate. Le cerveau est là, qui maîtrise style et discours. Du coup tout semble presque trop construit. C'est un peu froid, comme un livre de philo, j'en ai déjà parlé.
J'insiste. Je poursuis. Je me pose quand même la question de passer à autre chose, reprendre Les Bienveillantes, ou bien... Mon Dieu, j'avais même oublié que j'avais acheté Terrasse à Rome, de Quignard. Il faut vraiment que je me remette à lire convenablement. Les livres s'empilent que j'achète sans les lire, ou les lire à peine.
Après quelques pages me vient l'évidence de l'humour. Ca valait le coup d'insister, mais la véritable preuve que le texte marque sa route, c'est ce soir que je l'ai eue : le train de banlieue qui me conduisait de St Lazare aux Vallées. Bécon, dernier arrêt avant ma gare : une voix (la voix du conducteur) annonce que c'est le terminus, pour cause de perturbation le train ne poursuivra pas sa route, merci de quitter le train. Tout le monde sort, un peu ahuri, même pas énervé. C'est une gentille bousculade sur le quai : que faire ? Attendre le prochain ? Il ne va peut-être pas aux Vallées. Sortir et continuer à pied ? Prendre le bus ? un taxi ? La foule est spongieuse. J'ai alors la pleine sensation de faire de cette foule qui ne sait plus où aller. Aveugle au milieu des aveugles. Saramago m'a attrapé. Le roman est bon. Ca ressemble à un Haïku : le roman mal aimé / est soudain / le monde autour de moi. Ou un truc dans le genre.
A part ça, j'ai essayé d'écrire hier soir. La présence de Julie peut-être, ou l'envie de faire autre chose alors que je sens gonfler le désir de poursuivre le texte, bref : impossible d'aligner trois mots. La dernière fois que j'ai écrit une ligne remonte à quinze jours. A ce rythme, on n'est pas rendu.

La première sensation face à Saramago fut un peu plate. Le cerveau est là, qui maîtrise style et discours. Du coup tout semble presque trop construit. C'est un peu froid, comme un livre de philo, j'en ai déjà parlé.
J'insiste. Je poursuis. Je me pose quand même la question de passer à autre chose, reprendre Les Bienveillantes, ou bien... Mon Dieu, j'avais même oublié que j'avais acheté Terrasse à Rome, de Quignard. Il faut vraiment que je me remette à lire convenablement. Les livres s'empilent que j'achète sans les lire, ou les lire à peine.
Après quelques pages me vient l'évidence de l'humour. Ca valait le coup d'insister, mais la véritable preuve que le texte marque sa route, c'est ce soir que je l'ai eue : le train de banlieue qui me conduisait de St Lazare aux Vallées. Bécon, dernier arrêt avant ma gare : une voix (la voix du conducteur) annonce que c'est le terminus, pour cause de perturbation le train ne poursuivra pas sa route, merci de quitter le train. Tout le monde sort, un peu ahuri, même pas énervé. C'est une gentille bousculade sur le quai : que faire ? Attendre le prochain ? Il ne va peut-être pas aux Vallées. Sortir et continuer à pied ? Prendre le bus ? un taxi ? La foule est spongieuse. J'ai alors la pleine sensation de faire de cette foule qui ne sait plus où aller. Aveugle au milieu des aveugles. Saramago m'a attrapé. Le roman est bon. Ca ressemble à un Haïku : le roman mal aimé / est soudain / le monde autour de moi. Ou un truc dans le genre.
A part ça, j'ai essayé d'écrire hier soir. La présence de Julie peut-être, ou l'envie de faire autre chose alors que je sens gonfler le désir de poursuivre le texte, bref : impossible d'aligner trois mots. La dernière fois que j'ai écrit une ligne remonte à quinze jours. A ce rythme, on n'est pas rendu.

Sunday, November 19, 2006
Le Oui des fils
Finalement j'ai commencé L'Aveuglement, de Jose Saramago. Je sais assez peu de choses de l'écrivain : portugais, prix nobel, entendu parler pour la première fois il y a seulement quelques mois. Dans la foule phénoménale des livres disponibles, je choisis de préférence ceux dont on me parle avec passion. Les amis, les non professionnels, tous ceux qui ne cherchent rien à vendre. Saramago m'est arrivé un matin de bureau autour d'un café, par un collègue qui est désormais un ami.
Ce qui me frappe d'emblée, à l'issue des 50 premières pages, c'est l'absence de noms. Aucun des personnages à ce stade n'a de nom. C'est "le médecin", "l'autre" ou "sa femme".
La question du nom en matière de roman est cruciale à mes yeux. C'est une réelle affirmation. Certains personnages sont des titres devenus légendaires, voir mieux : noms communs. Don Quichotte, Corto Maltese, Monte Cristo, Madame Bovary... Que de valeurs et de symboles enclavées dans ces quelques lettres (à l'inverse un mauvais nom fait un mauvais titre : Julien Parme). Si ce n'est pas un titre, il faut que ce soit crédible, que le nom corresponde au style, qu'il ne choque pas, ou alors qu'il choque volontairement. Je reconnais à Amélie Nothomb une réelle imagination : Pretexta Tach, ça assure. Je serai néanmoins davantage marqué, et à vie probablement, par l'héroïsme contenu dans le simple nom du Dr. Rieux.
Les noms de mes personnages me viennent d'un coup : c'est comme ça, je pense, qu'ils sonnent le plus naturellement. Ils ont parfois un impact insoupçonné : si une Suzanne se nomme Susan, une Anna Hannah, j'obtiens des retours positifs. Les prénoms s'écrivent autant qu'ils se prononcent, et leurs valeurs sont différentes.
Saramago : Pas de noms.
Du coup, il plonge son livre dans un autre bain. on n'est plus dans le crédible mais bien dans la fable philosophique, politique, globale : les personnages sont des pions sans nom, switchables au profit de la cause, et qu'on oubliera. Il s'agit peut-être d'un sacrifice : seule l'oeuvre parle et a un nom. Hors de question de venir obscurcir son rayonnement, d'en détourner le sens. Des soldats inconnus.
Et pourtant : comme toute philosophie, toute politique, c'est de l'homme qu'il s'agit surtout. Pas de nom chez Saramago, mais pas de déshumanisation non plus. Juste de vaillants symboles. Intéressant.

Ce qui me frappe d'emblée, à l'issue des 50 premières pages, c'est l'absence de noms. Aucun des personnages à ce stade n'a de nom. C'est "le médecin", "l'autre" ou "sa femme".
La question du nom en matière de roman est cruciale à mes yeux. C'est une réelle affirmation. Certains personnages sont des titres devenus légendaires, voir mieux : noms communs. Don Quichotte, Corto Maltese, Monte Cristo, Madame Bovary... Que de valeurs et de symboles enclavées dans ces quelques lettres (à l'inverse un mauvais nom fait un mauvais titre : Julien Parme). Si ce n'est pas un titre, il faut que ce soit crédible, que le nom corresponde au style, qu'il ne choque pas, ou alors qu'il choque volontairement. Je reconnais à Amélie Nothomb une réelle imagination : Pretexta Tach, ça assure. Je serai néanmoins davantage marqué, et à vie probablement, par l'héroïsme contenu dans le simple nom du Dr. Rieux.
Les noms de mes personnages me viennent d'un coup : c'est comme ça, je pense, qu'ils sonnent le plus naturellement. Ils ont parfois un impact insoupçonné : si une Suzanne se nomme Susan, une Anna Hannah, j'obtiens des retours positifs. Les prénoms s'écrivent autant qu'ils se prononcent, et leurs valeurs sont différentes.
Saramago : Pas de noms.
Du coup, il plonge son livre dans un autre bain. on n'est plus dans le crédible mais bien dans la fable philosophique, politique, globale : les personnages sont des pions sans nom, switchables au profit de la cause, et qu'on oubliera. Il s'agit peut-être d'un sacrifice : seule l'oeuvre parle et a un nom. Hors de question de venir obscurcir son rayonnement, d'en détourner le sens. Des soldats inconnus.
Et pourtant : comme toute philosophie, toute politique, c'est de l'homme qu'il s'agit surtout. Pas de nom chez Saramago, mais pas de déshumanisation non plus. Juste de vaillants symboles. Intéressant.

Tuesday, November 14, 2006
Le nom du père

Quelle surprise. Je feuilletais le recueil d'oeuvres de Michel Déon que m'a offert Elodie pour mon anniversaire. Ce qu'il y a de parfaitement intéressant dans ce livre, c'est d'une part d'y trouver enfin des textes illustrés publiés en de rares exemplaires, et d'autre part les dernières pages, une biographie succinte de l'auteur rédigée par sa fille Alice. Déon avait déjà partagé quelques souvenirs et réflexions avec elle dans "Parlons-en", sous la forme d'un dialogue. Ici il n'intervient plus.
J'ai déjà et souvent et beaucoup parlé de Déon. Il est l'écrivain qui m'a bouleversé le plus profondément, qui a renversé mes fondements pour en ériger d'autres. 17 ans et les Poneys Sauvages en poche, je n'étais plus le même. L'enfance venait de s'éteindre, libérant de son oeuf un adulte encore gluand, un adulte tout frais ébloui par la lumière de ce qui devenait possible. LE choc littéraire. J'ai tout lu, mis à part certains de ces fameux livres introuvables (mais j'en ai trouvé d'autres), je suis même allé jusqu'à rencontrer le vieil académicien chez lui, en Irlande, voyage initiatique inestimable. J'y repense : j'ai découvert Déon par Le Jeune homme vert, lors d'un séjour à Ballina. Nos histoires se recoupent avec beaucoup de sympathie. Je ne vois pas comme un hasard que sa date de naissance soit la même que celle de Julie.
Mais est-ce vraiment a date de naissance ? Alice Déon m'apprend, dans le premier paragraphe, que Michel Déon n'est pas Michel Déon, mais Edouard Michel. Déon, c'est le nom (raccourci) de sa mère. Tout se recoupe alors : Edouard alias Teddy, dans La Chambre de ton père, roman autobiographique. Ted, dans Un Souvenir... Des pistes s'éclairent, en brouillant d'autres. L'histoire n'est pas terminée. Ce qui devait être un secret de Polichinel dans les miliex littéraires parisiens était à mes yeux un secret inconcevable. Déon n'est pas Déon, quel vertige pour moi qui pensait le connaître si bien. Quel plaisir également, surtout et enfin, d'être à nouveau surpris.

Monday, November 06, 2006
Déçu et en colère
Je jette l'éponge page 340. 50 avant la fin. Tant pis pour Tillinac et surtout pour moi.
Bah, ça arrive. "Je nous revois..." radote, tourne en rond, et ne se résoud jamais. 390 pages pour ça, ça laisse le goût de l'erreur. Je suis trop loin de "En désespoir de causes" ou même de "L'été anglais".
Pour bien finir j'ai lu le dernier paragraphe et oui, vraiment, il valait mieux en rester là, depuis un moment même.
J'ai aimé le style, comme d'habitude avec Tillinac, mais même le style eut bientôt l'air de s'ennuyer.
Je n'aime pas ça du tout. C'est un sentiment de colère. Je lui en veux, oui, un peu, à Tillinac, de s'être laissé porter par une veine redondante inutile. Ca va bien, ses histoires d'amour froissées de quinqua qui jouent aux ados. Il fallait continuer, pousser plus loin, arriver, même nulle part, tout plutôt que ce lambinage. On m'annonçait dès la première phrase du 4ème de couverture la montée et la chute d'un grand patron. Page 340 : toujours pas l'ombre d'une chute. Ca sent le foutage de gueule, le remplissage à sec. Colère, vraiment. Je lis mes livres comme je passe mes soirées : entre amis. Confiant dans la surprise, rassuré d'être étonné. Alors quand vos meilleurs potes vous lâchent en même temps qu'ils se traînent de page en page, c'est dur.
J'ai du coup attaqué les cours de littérature anglaise que Borges a donné entre 1966 et 1967. C'est prenant, mais ce n'est pas un roman. Un roman me manque maintenant. Les Bienveillantes, peut-être ? Mon exemplaire est un cadeau, en plus. Mais ses 900 pages me terrifient. Je n'en serai jamais venu à bout à Noël. Je n'ai pas non plus envie d'abandonner un autre roman tout de suite. Je relirais volontiers un Camus, Noces, mais je ne l'ai qu'en Pléiade (pardon), incompatible avec les transports en commun. Relire Dorian Gray ?
Borges : "Les intentions des auteurs sont moins importantes que les bonheurs de leur création".

Bah, ça arrive. "Je nous revois..." radote, tourne en rond, et ne se résoud jamais. 390 pages pour ça, ça laisse le goût de l'erreur. Je suis trop loin de "En désespoir de causes" ou même de "L'été anglais".
Pour bien finir j'ai lu le dernier paragraphe et oui, vraiment, il valait mieux en rester là, depuis un moment même.
J'ai aimé le style, comme d'habitude avec Tillinac, mais même le style eut bientôt l'air de s'ennuyer.
Je n'aime pas ça du tout. C'est un sentiment de colère. Je lui en veux, oui, un peu, à Tillinac, de s'être laissé porter par une veine redondante inutile. Ca va bien, ses histoires d'amour froissées de quinqua qui jouent aux ados. Il fallait continuer, pousser plus loin, arriver, même nulle part, tout plutôt que ce lambinage. On m'annonçait dès la première phrase du 4ème de couverture la montée et la chute d'un grand patron. Page 340 : toujours pas l'ombre d'une chute. Ca sent le foutage de gueule, le remplissage à sec. Colère, vraiment. Je lis mes livres comme je passe mes soirées : entre amis. Confiant dans la surprise, rassuré d'être étonné. Alors quand vos meilleurs potes vous lâchent en même temps qu'ils se traînent de page en page, c'est dur.
J'ai du coup attaqué les cours de littérature anglaise que Borges a donné entre 1966 et 1967. C'est prenant, mais ce n'est pas un roman. Un roman me manque maintenant. Les Bienveillantes, peut-être ? Mon exemplaire est un cadeau, en plus. Mais ses 900 pages me terrifient. Je n'en serai jamais venu à bout à Noël. Je n'ai pas non plus envie d'abandonner un autre roman tout de suite. Je relirais volontiers un Camus, Noces, mais je ne l'ai qu'en Pléiade (pardon), incompatible avec les transports en commun. Relire Dorian Gray ?
Borges : "Les intentions des auteurs sont moins importantes que les bonheurs de leur création".

Sunday, October 22, 2006
Journal d'un lecteur
La séparation est cruelle, quand on arrive à la fin d'un livre. J'ai terminé le Journal d'un lecteur, d'Alberto Manguel, hier, dans le train qui me conduisait de Saint-Lazare à Colombes.
Cela faisait quelques semaines que je le lisais. Par bribes, peu de pages à la fois, et le plus souvent dans les transports en commun. Je ne les prends pas souvent, ma lecture avançait peu. Et puis, il est question dans ce journal de livres que je n'ai pas lus, j'étais du coup un peu réticent à en achever la lecture. Ca ne me parlait pas plus que ça.
Mais Manguel est homme intelligent. Sa plume est riche sans ostentation, ce qui est la plus grande qualité chez un écrivain, de mon point de vue. Avancer avec lui de mois en mois et de livre en livre, retrouver avec lui une actualité jeune (son journal est parallèle au déclenchement de la seconde guerre du Golfe), partager l'écho de ses lectures sur son quotidien, témoigner ainsi du pudique amour, mais amour quand même, pour les titres choisis, et enfin réussir à m'intéresser à un livre de Goethe, voici qui a insidieusement créé entre Alberto et moi une connivence aux reflets amicaux. Oui, c'est un rapport très proche de l'amitié qui s'est noué entre les deux lecteurs. Je retrouvais Alberto dans l'intimité de ses lectures parce qu'il m'y accueillait chaleureusement, en toute affection et en pleine confiance. Il m'invitait chez lui, dans cette maison du sud de la France qu'il apprécie tant. Ou bien il m'envoyait des cartes postales des différents pays où il était invité pour des conférences qui nourrissaient le nécessaire regret de quitter, pour un temps, sa bibliothèque. Vraiment, je me suis senti chez lui comme en vacances, protégé de la pluie fine, goûtant silencieusement le soleil, bercé du murmure des pages dans la cuisine appaisée, encore le meilleur endroit pour lire. Aberto et moi sommes devenus amis et, je le cite citant Machado de Assis, Borgès et Descartes : "la page de titre d'un livre devrait comporter les deux noms de l'auteur et du lecteur, puisque tous deux en partagent la paternité." J'y vois davantage les noms gravés sur un arbre par deux jeunes camarades qui ne se quitteront plus, d'autant moins si la distance les sépare, mais l'idée reste la même. Alberto écrit des choses simples qui me font réflechir sur mon travail. Il est une oreille attentive et compréhensive. Grâce à lui j'ai désormais envie de lire Machado, mais aussi Sei Shônagon et Margaret Atwood.
J'ai annoté quelques pages (136, 146, 164, 173, 185), en ai lues à Franck ou à Julie comme on rapporte le trait d'humour ou de génie d'un copain avec qui l'on vient de passer un bon moment. J'aime beaucoup parler de mes amis. Mais voilà : le livre est désormais terminé. Je sais que j'y reviendrai, et que je lirai Alberto ailleurs encore. Je nous prépare de belles heures fraternelles. Le moment de la dernière page, de la dernière ligne, celui-ci est triste. C'est une sensation physique douloureuse qui fait monter des sanglots éteints.

Cela faisait quelques semaines que je le lisais. Par bribes, peu de pages à la fois, et le plus souvent dans les transports en commun. Je ne les prends pas souvent, ma lecture avançait peu. Et puis, il est question dans ce journal de livres que je n'ai pas lus, j'étais du coup un peu réticent à en achever la lecture. Ca ne me parlait pas plus que ça.
Mais Manguel est homme intelligent. Sa plume est riche sans ostentation, ce qui est la plus grande qualité chez un écrivain, de mon point de vue. Avancer avec lui de mois en mois et de livre en livre, retrouver avec lui une actualité jeune (son journal est parallèle au déclenchement de la seconde guerre du Golfe), partager l'écho de ses lectures sur son quotidien, témoigner ainsi du pudique amour, mais amour quand même, pour les titres choisis, et enfin réussir à m'intéresser à un livre de Goethe, voici qui a insidieusement créé entre Alberto et moi une connivence aux reflets amicaux. Oui, c'est un rapport très proche de l'amitié qui s'est noué entre les deux lecteurs. Je retrouvais Alberto dans l'intimité de ses lectures parce qu'il m'y accueillait chaleureusement, en toute affection et en pleine confiance. Il m'invitait chez lui, dans cette maison du sud de la France qu'il apprécie tant. Ou bien il m'envoyait des cartes postales des différents pays où il était invité pour des conférences qui nourrissaient le nécessaire regret de quitter, pour un temps, sa bibliothèque. Vraiment, je me suis senti chez lui comme en vacances, protégé de la pluie fine, goûtant silencieusement le soleil, bercé du murmure des pages dans la cuisine appaisée, encore le meilleur endroit pour lire. Aberto et moi sommes devenus amis et, je le cite citant Machado de Assis, Borgès et Descartes : "la page de titre d'un livre devrait comporter les deux noms de l'auteur et du lecteur, puisque tous deux en partagent la paternité." J'y vois davantage les noms gravés sur un arbre par deux jeunes camarades qui ne se quitteront plus, d'autant moins si la distance les sépare, mais l'idée reste la même. Alberto écrit des choses simples qui me font réflechir sur mon travail. Il est une oreille attentive et compréhensive. Grâce à lui j'ai désormais envie de lire Machado, mais aussi Sei Shônagon et Margaret Atwood.
J'ai annoté quelques pages (136, 146, 164, 173, 185), en ai lues à Franck ou à Julie comme on rapporte le trait d'humour ou de génie d'un copain avec qui l'on vient de passer un bon moment. J'aime beaucoup parler de mes amis. Mais voilà : le livre est désormais terminé. Je sais que j'y reviendrai, et que je lirai Alberto ailleurs encore. Je nous prépare de belles heures fraternelles. Le moment de la dernière page, de la dernière ligne, celui-ci est triste. C'est une sensation physique douloureuse qui fait monter des sanglots éteints.

Friday, October 13, 2006
Je bois la tasse
Ainsi, probablement, va l'écriture. Hier mon hurloir me renvoyait une chaleur bienveillante. Le texte se tenait à peu près, certains passages étaient honnêtes.
Et puis je relis aujourd'hui et je trouve ça naze. Je trouve ça gamin, je trouve que certains passages entiers manquent de maturité, je trouve ça gonflé aux hormones, artificiellement mûri, enfin bref.
Peut-être la faute à mes lectures. Ecrire après Tillinac, c'est complexe. Il prend le temps d'un chapitre entier pour un personnage alors que je me précipite sur un paragraphe et c'est plié. 150 pages et l'action commence à peine, contre 15 de mes feuilles et tout est déjà presque dit.
Déon le résume dans "Jeu de miroir" : pour écrire il faut avoir lu, mais lire empêche d'écrire car on voudrait faire aussi bien sans pouvoir, nous semble-t-il, y parvenir.
Je ne bosserai donc probablement pas sur le texte aujourd'hui. Tout ses défauts se percutent, je suis très gêné par ce que je lis.
Et puis je relis aujourd'hui et je trouve ça naze. Je trouve ça gamin, je trouve que certains passages entiers manquent de maturité, je trouve ça gonflé aux hormones, artificiellement mûri, enfin bref.
Peut-être la faute à mes lectures. Ecrire après Tillinac, c'est complexe. Il prend le temps d'un chapitre entier pour un personnage alors que je me précipite sur un paragraphe et c'est plié. 150 pages et l'action commence à peine, contre 15 de mes feuilles et tout est déjà presque dit.
Déon le résume dans "Jeu de miroir" : pour écrire il faut avoir lu, mais lire empêche d'écrire car on voudrait faire aussi bien sans pouvoir, nous semble-t-il, y parvenir.
Je ne bosserai donc probablement pas sur le texte aujourd'hui. Tout ses défauts se percutent, je suis très gêné par ce que je lis.
Extrait
Susan était splendide. Véritablement magnifique. Ses cheveux gris qu'elle laissait pousser sans complexe étaient la preuve d'une acceptation d'elle-même qui relevait du sacrifice, voire de l'abnégation. Elle niait toute coquetterie, qui existe encore tant chez les femmes de son âge. Soixante ans et coquette, ça ne rimait à rien, pour Henri. Une femme qui dégageait du charme, c'était d'abord une femme en pleine possession d'elle-même, de son corps, et des bonheurs que son âge lui apportait. Une femme qui laissait venir le temps, les rides, les peines, les désirs. Le meilleur moyen qu'ait un être humain d'être attirant était de saluer chaque jour comme une joie. L'attirance est une leçon de vie, une offrande faite à l'autre de ce qu'il n'a pas. L'âge ne fait rien à l'affaire. On souffre à cinq, vingt-cinq et soixante-quinze ans. On est beau aux mêmes âges. Refuser de recevoir ce que chaque année nous offrait sur un plateau de soleil, quelle connerie. Cela n'empêchait en rien de faire face, en cas de problème. Et des problèmes, il y en avait tous les jours. Question d'habitude, une habitude qui, il fallait le reconnaître, venait de plus en plus facilement. Non, elle était tout sauf coquette. Mais elle ne se négligeait pas pour autant. Elle semblait pouvoir porter n'importe quoi avec une élégance unique. Sa couleur était le noir, mais vous la croisiez avec un long châle bariolé un soir d'automne et vous ne reteniez d'elle qu'une volée de couleurs. L'élégance est le contraire de la coquetterie.
A ce titre, et parce qu'elle était habitée d'une dimension impénétrable qui conférait à chacun de ses gestes, de ses mots, une richesse humaine qui semblait la dépasser, Susan était une reine.
A ce titre, et parce qu'elle était habitée d'une dimension impénétrable qui conférait à chacun de ses gestes, de ses mots, une richesse humaine qui semblait la dépasser, Susan était une reine.
Le paradoxe Tillinac
Paradoxe, parce que Denis Tillinac diffuse à la fois une résignation mélancolique sur la fin de la civilisation et un enthousiasme limite adolescent.
Dans "Je nous revois..." qui me sert de cahier de vacances (et bien plus) pour cette expérience d'écriture en résidence pornichétine, l'alchimie se vérifie encore. Si ses personnages sont des industriels, artistes ou diplomates revenus de tout, si les femmes sont des drames somptueux, le narrateur n'en demeure pas moins capable de s'enflammer pour un sourire, de s'envoler pour Vienne rejoindre un amour auquel, pourtant, il ne croit plus, de saluer un peintre de ses amis alors que "Picasso selon lui avait mis à mort toute l'histoire de l'art en un carambolage génial" (p. 105).
Ce que j'ai vu de l'homme Tillinac relève du même, pour ce que j'en devine. Un type à l'abord peu engageant, front dur, regard d'acier, carrure de taureau, voix de fumeur qui en a fumé d'autres et des bien pires. Et pourtant : le même homme s'est enthousiasmé quand avec une poignée d'amis nous lui avons présenté un projet de magazine culturel gratuit. Tillinac, patron de la Table Ronde, qui a pris une bonne heure de son temps à nous écouter ("Je n'ai qu'une demi heure, ça ira ?"), et à se projeter, je veux le croire, dans une idée plus grosse que nous qui nous avalerait tout cru.
Voilà ce qui m'accompagne cette semaine et fournit un angle riche à mon travail. Et puis ceci : ce type capable d'ironie, voire de cynisme, s'en empêche, surtout dans ses livres. Un trait d'humour doit être fin, élégant, même avec des mots lourds. Le cynisme lui semble être une impolitesse dont il se garde. J'y vois une grande générosité. Alors même qu'il serait parfaitement capable de glisser davantage d'humour dans son roman, Tillinac assume le premier degré. C'est courageux, et la preuve d'une humanité qui est une leçon. Puissent désormais mes personnages s'autoriser ce premier degré qui les entraîne au bout d'eux-mêmes, et délivrer une humanité aussi chaleureuse. Mes personnages, donc moi. Cela m'apparaît soudain comme ma véritable mission.

Dans "Je nous revois..." qui me sert de cahier de vacances (et bien plus) pour cette expérience d'écriture en résidence pornichétine, l'alchimie se vérifie encore. Si ses personnages sont des industriels, artistes ou diplomates revenus de tout, si les femmes sont des drames somptueux, le narrateur n'en demeure pas moins capable de s'enflammer pour un sourire, de s'envoler pour Vienne rejoindre un amour auquel, pourtant, il ne croit plus, de saluer un peintre de ses amis alors que "Picasso selon lui avait mis à mort toute l'histoire de l'art en un carambolage génial" (p. 105).
Ce que j'ai vu de l'homme Tillinac relève du même, pour ce que j'en devine. Un type à l'abord peu engageant, front dur, regard d'acier, carrure de taureau, voix de fumeur qui en a fumé d'autres et des bien pires. Et pourtant : le même homme s'est enthousiasmé quand avec une poignée d'amis nous lui avons présenté un projet de magazine culturel gratuit. Tillinac, patron de la Table Ronde, qui a pris une bonne heure de son temps à nous écouter ("Je n'ai qu'une demi heure, ça ira ?"), et à se projeter, je veux le croire, dans une idée plus grosse que nous qui nous avalerait tout cru.
Voilà ce qui m'accompagne cette semaine et fournit un angle riche à mon travail. Et puis ceci : ce type capable d'ironie, voire de cynisme, s'en empêche, surtout dans ses livres. Un trait d'humour doit être fin, élégant, même avec des mots lourds. Le cynisme lui semble être une impolitesse dont il se garde. J'y vois une grande générosité. Alors même qu'il serait parfaitement capable de glisser davantage d'humour dans son roman, Tillinac assume le premier degré. C'est courageux, et la preuve d'une humanité qui est une leçon. Puissent désormais mes personnages s'autoriser ce premier degré qui les entraîne au bout d'eux-mêmes, et délivrer une humanité aussi chaleureuse. Mes personnages, donc moi. Cela m'apparaît soudain comme ma véritable mission.

Thursday, October 12, 2006
Size matters
Jeudi. Ce matin m'est revenu un doute récurrent à mes travaux d'écriture : alors que j'ai l'impression d'en être à la moitié du texte, j'accumule à peine une vingtaine de pages. 20 pages Word, format A4, qui feront 2,5 fois plus de pages imprimées, mais quand même.
Je vais continuer à avancer, et je verrai une fois la dernière scène posée s'il manque des éléments d'ambiance qui pourraient venir gonfler le tout. Le souci reste qu'une ambiance ne doit pas être décrite formellement, elle doit être suggérée, flotter sur le texte de façon diffuse mais présente. L'énoncer c'est la casser.
Je vais continuer à avancer, et je verrai une fois la dernière scène posée s'il manque des éléments d'ambiance qui pourraient venir gonfler le tout. Le souci reste qu'une ambiance ne doit pas être décrite formellement, elle doit être suggérée, flotter sur le texte de façon diffuse mais présente. L'énoncer c'est la casser.
Wednesday, October 11, 2006
Objectif mars
Mercredi. La semaine dernière j'ai dîné avec Nico, qui a maquetté intégralement "La Fille de l'aventurier".
Ca faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Les semaines qui séparent accroissent le plaisir des retrouvailles. On a rattrapé le temps. Vacances. Ecosse. Les filles. Le boulot. Les oeufs au foie gras du Potager, à Abesses, sont une merveille.
Selon Nico, le recueil des "Histoires jamais entendues dans un pub en Irlande" sortirait volontiers pour la Saint Patrick, le 17 mars prochain. Marché conclu. De toute façon c'est trop court pour Noël et ce sera avec Nico ou rien.
Prévoyons un séjour en Irlande en janvier pour enterriner, et pour bosser dessus.
Ca faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Les semaines qui séparent accroissent le plaisir des retrouvailles. On a rattrapé le temps. Vacances. Ecosse. Les filles. Le boulot. Les oeufs au foie gras du Potager, à Abesses, sont une merveille.
Selon Nico, le recueil des "Histoires jamais entendues dans un pub en Irlande" sortirait volontiers pour la Saint Patrick, le 17 mars prochain. Marché conclu. De toute façon c'est trop court pour Noël et ce sera avec Nico ou rien.
Prévoyons un séjour en Irlande en janvier pour enterriner, et pour bosser dessus.
Tuesday, October 10, 2006
Pas d'heure
Ce qui est positif, c'est que je réussis à m'affranchir du diktat des heures. Après une journée à peine croyable, plein soleil, déjeuner dehors et T-shirt sur la plage, je me suis attelé à la tâche en fin d'après-midi. Je retrouve goût au travail. Parti avec un cadre, un objectif, je ne l'atteins qu'en m'en détâchant. Je voulais bosser 7 à 8 heures pas jour, de 9 à 12 puis de 14 à 16, voeu pieux. Sans heure, j'avance mieux et moins complexé.
Quignard : la liberté ne signifie rien. Seule la libération a un sens.
22h24 : à table.
Quignard : la liberté ne signifie rien. Seule la libération a un sens.
22h24 : à table.
Un extrait
"Il se demandait si elle aimait le poisson. A cette heure, c'était un peu tard. Il n'en aurait de frais, le meilleur, que le matin. Chez son ami Tony il acheta un bon kilo de tomates, pour le gaspacho. Ca ne la nourrirait pas ce soir. L'emmener au restaurant ? Ce serait l'occasion de discuter, de mieux la connaître, sans trop insister, dans un contexte rassurant. Il était pourtant convaincu que le cadre le plus propice à des confidences était encore chez lui. La cuisine surtout, l'éclairage voilé du plafonnier sur les bois sombres des meubles, le crépi passé, la chaleur brune des tomettes au sol, le bouillon épais d'une eau de cuisson, il s'y sentait bien et quelques femmes avaient apprécié. Depuis sa séparation avec Mathilde elles n'avaient pas été si nombreuses à franchir ce seuil. Mais aucune n'était repartie foncièrement fâchée. Du moins voulait-il encore le croire, et ma foi il n'avait jamais encore reçu de plainte. Au contraire, toutes avaient apprécié, à différents degrés, le calme rassérénant de la pièce, la lumière battue, le parfum, sel, sable et agrumes. Hannah ne voulait pas faire l'amour ailleurs que dans la cuisine."
Journal de Porn' - Jour 2
Mieux dormi que la nuit dernière. Couché à 2 heures après une dernière heure de travail et une demi de lecture. Je me suis arrêté de relire juste avant les passages écrits le jour même. Je n'avais pas encore assez de recul pour les juger convenablement.
Je me suis endormi assez peu content de ce que j'ai fait. Au matin, un goût brouillon dans la bouche. J'ai réflechi au manque de plaisir pris hier à accomplir un labeur qui n'avait de satisfaisant que le respect d'une technique. J'y ai réflechi en faisant quelques courses, puis une promenade sur la plage, il était temps. Ca éclaircit les idées. Il faut que j'abandonne au plus tôt le côté disciplinaire de mon travail pour libérer le plaisir d'écrire, et d'écrire bien. Du mieux que je peux, au moins. Quitte à revenir dessus plus tard, trouver ça chiant, et refaire.
De retour, j'ai repris l'exercice, avec l'idée que j'allais tout effacer. Je ne voulais pas conserver un sentiment bancal. En relisant à haute voix ce que j'ai écrit hier soir et dans l'après-midi, j'ai finalement trouvé ça pas si mal. Il est très difficile de juger mon texte maintenant, déjà. La lecture à haute voix nous a réconcilié. Jusqu'à la prochaine lecture ? Profitons pour l'instant de ce regain d'intérêt. Et puis, à table !
Je me suis endormi assez peu content de ce que j'ai fait. Au matin, un goût brouillon dans la bouche. J'ai réflechi au manque de plaisir pris hier à accomplir un labeur qui n'avait de satisfaisant que le respect d'une technique. J'y ai réflechi en faisant quelques courses, puis une promenade sur la plage, il était temps. Ca éclaircit les idées. Il faut que j'abandonne au plus tôt le côté disciplinaire de mon travail pour libérer le plaisir d'écrire, et d'écrire bien. Du mieux que je peux, au moins. Quitte à revenir dessus plus tard, trouver ça chiant, et refaire.
De retour, j'ai repris l'exercice, avec l'idée que j'allais tout effacer. Je ne voulais pas conserver un sentiment bancal. En relisant à haute voix ce que j'ai écrit hier soir et dans l'après-midi, j'ai finalement trouvé ça pas si mal. Il est très difficile de juger mon texte maintenant, déjà. La lecture à haute voix nous a réconcilié. Jusqu'à la prochaine lecture ? Profitons pour l'instant de ce regain d'intérêt. Et puis, à table !
Monday, October 09, 2006
Pornichet jour 1
En fait, Pornichet jour X, puisqu'il y a déjà eu un Belle-Île jour X-1, et que le véritable jour 1 eut lieu à Banalbufar, petit village majorquain.
Arrivé hier soir avec Gilles. Objectif : 1 semaine d'écriture de ce qui se nomme pour l'instant "En compagnie des hommes". J'ai pris ces jours de vacances pour ne faire que ça. Lire aussi, mais ça fait partie du boulot. Mon cahier de vacances est "Je nous revois..." de Tillinac. Le style du patron de la Table Ronde me scie toujours. Première phrase : "Via Giullia. Soleil d'automne sur les murs ocres des palais." déjà sue par coeur.
Quelques uns m'ont fait l'honneur de lire les quelques premières pages. Merci, j'en ai pris bonne note. Je me suis attelé à la tâche dès ce matin. Je sens l'intensité du travail et la plongée au coeur de cette expérience croître sourdement. Je m'en réjouis.
Arrivé hier soir avec Gilles. Objectif : 1 semaine d'écriture de ce qui se nomme pour l'instant "En compagnie des hommes". J'ai pris ces jours de vacances pour ne faire que ça. Lire aussi, mais ça fait partie du boulot. Mon cahier de vacances est "Je nous revois..." de Tillinac. Le style du patron de la Table Ronde me scie toujours. Première phrase : "Via Giullia. Soleil d'automne sur les murs ocres des palais." déjà sue par coeur.
Quelques uns m'ont fait l'honneur de lire les quelques premières pages. Merci, j'en ai pris bonne note. Je me suis attelé à la tâche dès ce matin. Je sens l'intensité du travail et la plongée au coeur de cette expérience croître sourdement. Je m'en réjouis.
Il y avait déjà un début
Sur histoires.blogspot.com vous trouverez le journal d'écriture de mon précédent roman, ainsi que quelques textes réunis sous la bannière des "Histoires jamais entendues dans un pub en Irlande".
Ce nouveau blog a plusieurs raisons d'être :
- Je suis en pleine rédaction d'un autre roman, et je souhaite tracer ici le journal de son écriture.
- Je souhaite publier pour la St Patrick (17 mars 2007) le recueil des Histoires jamais entendues... mentionnées ci-dessus, et fédérer ici quelques avis ou commentaires.
- J'ai d'autres projets d'écriture en cours et veut recenser dans ces lignes leurs doutes et leurs espoirs.
- j'ai paumé les codes d'accès à histoires.blogspot.com.
Cheers, mates.
Ce nouveau blog a plusieurs raisons d'être :
- Je suis en pleine rédaction d'un autre roman, et je souhaite tracer ici le journal de son écriture.
- Je souhaite publier pour la St Patrick (17 mars 2007) le recueil des Histoires jamais entendues... mentionnées ci-dessus, et fédérer ici quelques avis ou commentaires.
- J'ai d'autres projets d'écriture en cours et veut recenser dans ces lignes leurs doutes et leurs espoirs.
- j'ai paumé les codes d'accès à histoires.blogspot.com.
Cheers, mates.
Subscribe to:
Posts (Atom)



